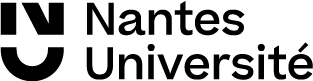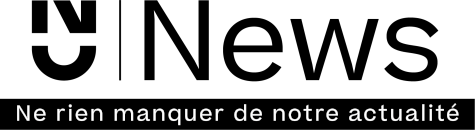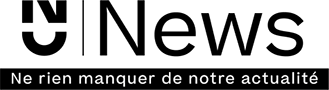- Ouverture des connaissances
- Recherche
[Portrait] Science ouverte - Nicolas CORREARD, respecter la qualité des publications
https://u-news.univ-nantes.fr/medias/photo/nicolas-correard-unews_1683642012990-jpg
Nicolas CORREARD est maître de conférences en littérature comparée à Nantes Université (UFR Lettres et langage). Spécialiste du XVIe et XVIIe siècles, il a pour thèmes de recherche la satire littéraire, le champ de ce qu’il nomme la littérature "sério-comique" de la Renaissance et les relations entre littérature et histoire des idées. En écho à ses responsabilités au laboratoire LAMo, il encourage une science ouverte capable de garantir la qualité des publications et l’exercice d’un contrôle par les auteurs, tout en mettant en garde contre un usage indiscriminé de l’outil HAL.
 Au fil de son parcours universitaire, Nicolas Correard a publié de nombreux articles de revues, chapitres d’ouvrages collectifs, compte rendus, actes de colloques... Une partie de ses textes a été diffusée en ligne. Il fait ainsi partie de "la première génération de chercheurs à pratiquer le numérique" pour ses publications. Mieux encore, il a rapidement effectué des dépôts en archive ouverte "pratiquant la science ouverte avant que la notion ne soit définie", en tant qu’enseignant-chercheur comme en tant que membre directeur adjoint du LAMo (Littératures antiques et modernes), qui édite la revue en ligne Atlantide, en accès ouvert depuis sa fondation en 2014.
Au fil de son parcours universitaire, Nicolas Correard a publié de nombreux articles de revues, chapitres d’ouvrages collectifs, compte rendus, actes de colloques... Une partie de ses textes a été diffusée en ligne. Il fait ainsi partie de "la première génération de chercheurs à pratiquer le numérique" pour ses publications. Mieux encore, il a rapidement effectué des dépôts en archive ouverte "pratiquant la science ouverte avant que la notion ne soit définie", en tant qu’enseignant-chercheur comme en tant que membre directeur adjoint du LAMo (Littératures antiques et modernes), qui édite la revue en ligne Atlantide, en accès ouvert depuis sa fondation en 2014."Le caractère non coûteux et le caractère universel" des textes déposés sur une archive ouverte sont "deux avantages décisifs". Pour Nicolas Correard, cela représente même "une révolution dans l’espace de la recherche", bousculant à la fois le système de l’édition et le rapport au lectorat. "Un article diffusé en science ouverte dispose d’un potentiel de lecture et de diffusion beaucoup plus important", ce qui rebat les cartes entre centralités et périphéries.
Surtout si l'article en question est particulièrement érudit, il sera alors "beaucoup plus lu et cité" qu’édité uniquement en version papier. "J’ai été sollicité par des chercheurs italiens et canadiens dont j’ignorais l’existence et le travail suite à la publication d’un texte sur un auteur de la Renaissance (Cornelius Agrippa) connu que de quelques rares spécialistes".
L'accès ouvert, une opportunité pour des auteurs
Toutefois, Nicolas Correard assure "qu'il ne s’agit pas de tout déposer sur HAL", soulignant que "l’objectif est de bien publier", si besoin avec le soutien du Service Archivage et Diffusion de la recherche. Il craint, comme plusieurs collègues, que l’exigence d’une "mise en ligne rapide et massive" ne nuise à la qualité des textes édités, tant sur la forme que sur le fond, les laboratoires ne disposant absolument pas, en l’état actuel, de personnel pour les assister dans un travail de contrôle des données et de mise en forme professionnelle actuellement effectué par certains éditeurs. Le passage à la science ouverte doit se faire en concertation avec l’édition universitaire traditionnelle, en respectant par ailleurs la tradition de l’imprimé.
De nombreux collègues directs ont d’ailleurs des réserves beaucoup plus fondamentales vis-à-vis de l’obligation de dépôt des textes dans HAL adoptée par Nantes Université. Il est important d’écouter leurs arguments, d’envisager toutes les conséquences. Nicolas Correard plaide pour une approche plus souple. "Que tout soit déposé sur HAL est difficilement concevable. Que toutes les notices soient sur HAL est un bon objectif". Investi dans la science ouverte, il interpelle les responsables pour l’amélioration de la plateforme, qu’il considère comme "quelque chose de très positif", particulièrement pour la simplicité de téléchargement d’articles et la diffusion des collections de laboratoire.
De nombreux collègues directs ont d’ailleurs des réserves beaucoup plus fondamentales vis-à-vis de l’obligation de dépôt des textes dans HAL adoptée par Nantes Université. Il est important d’écouter leurs arguments, d’envisager toutes les conséquences. Nicolas Correard plaide pour une approche plus souple. "Que tout soit déposé sur HAL est difficilement concevable. Que toutes les notices soient sur HAL est un bon objectif". Investi dans la science ouverte, il interpelle les responsables pour l’amélioration de la plateforme, qu’il considère comme "quelque chose de très positif", particulièrement pour la simplicité de téléchargement d’articles et la diffusion des collections de laboratoire.
"Un article diffusé en science ouverte dispose d’un potentiel de lecture et de diffusion beaucoup plus important"
Malgré tout, dans l’écosystème de l’édition, la publication en accès ouvert "réduit les frais, permettant de réserver un budget pour l’édition papier", qui reste importante, notamment pour les ouvrages individuels, avec une complémentarité à trouver entre ces deux modes. Une opportunité pour des auteurs qui "restent très attachés au livre" et au savoir-faire éditorial ! Cette voie permet également de "sortir du modèle" instauré par des éditeurs ayant développé des accès payants aux tarifs parfois élevés. Tout en renouvelant les pratiques de publication, la "diffusion universelle" offre une alternative qui permet de contourner "des éditeurs à l’approche capitalistique", lesquels, en général, ne sont pas français, mais dictent leur loi sur un marché internationalisé de la recherche.
Dans la même série
Nantes Université est engagée dans la démarche dite "Open". Celle-ci se décline en plusieurs axes : l'éducation ouverte, l'innovation ouverte et la science ouverte. Sur ce dernier axe, l'université est investie dans l'ouverture des publications scientifiques et incite sa communauté à déposer ses articles scientifiques dans l'archive ouverte HAL, infrastructure publique commune à l'ensemble des universités et organismes de recherche français, qui garantit une visibilité internationale et un archivage pérenne aux publications qui y sont déposées. Cinq enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses portent leur regard sur l'ouverture des publications.
La Bibliothèque universitaire vous accompagne
La Bibliothèque universitaire vous propose 2 dispositifs pour vous accompagner dans votre démarche de Science ouverte :
- Science ouverte sur rendez-vous
- HAL'aide
Pour toutes vos questions sur le dépôt dans HAL, la diffusion des thèses et des HDR, la publication en accès ouvert, les données de la recherche :
- Une seule adresse mail : bu-science-ouverte@univ-nantes.fr
- Une seule page web : https://bu.univ-nantes.fr/science-ouverte
Mis à jour le 21 novembre 2023.